|
|
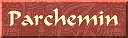
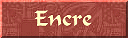
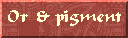


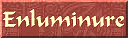 |
| |
-
L' or :
Il se présente en poudre ou en
feuille. L'or en coquille permet une application au pinceau
pour la réalisation de fins détails.
La feuille libre est très délicate à
manier parce que d'une extrême légèreté. On utilise pour la
manipuler à l'abri de tout courant d'air, un coussin et un couteau
à dorer.
La feuille d'or d'applique, d'une qualité
égale, est d'une
utilisation plus aisée puisque adhérente à une feuille.
L'or se pose sur "une assiette". Il s'agit d'une mixtion
qui va permettre à l'or d'adhérer sur le parchemin.
Ainsi, pour un aspect bombé, on utilisera généralement un
gesso dont il existe plusieurs recettes à base de colle de peau de
poisson ou de lapin, et de plâtre éteint. L'épaisseur du gesso donne du volume à la surface
dorée.
L'ensemble des ingrédients est mélangé dans un mortier avant d'y ajouter
la colle de peau de poisson et parcimonieusement de l'eau de pluie
jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse dépourvue de grumeau et de bulles
d'air.
|
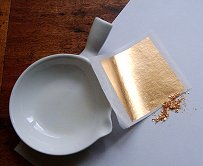 |
D'autres techniques donnent un rendu
de l'or plus à plat , on utilisera
alors par exemple la gomme ammoniaque , ou la gomme de cerisier et pourquoi pas le jus
d'ail....
Une fois l'assiette sèche et dure, on la réhumidifie en soufflant
dessus, cela la rend à nouveau collante. On peut alors y déposer
délicatement la feuille d'or.
Vient alors l'ultime étape que l'on appelle le brunissage. Il s'agir de
polir la surface dorée à l'aide d'une agate afin de la faire briller de
mille éclats.
|
 |
Même si la modernité nous permet aujourd'hui d'utiliser des pigments
synthétiques, l'enlumineur s'attache aux méthodes médiévales en
utilisant des pigments dits "historiques".
Quelques ouvrages font référence en ce domaine et nous permettent de
retrouver les recettes de nos aînés:
- Il libro dell'arte, de Cennino Cennini
- L'art de l'enluminure, de Louis Dimier
- L'essai de Théophilius...
|
|
|
Pigments d'origine végétale:
Les recettes varient quelque peu
suivant la plante, ainsi on utilisera les fleurs, le plant ou la racine,
ou encore la résine que l'on nomme "gomme".
En général la matière tinctoriale est extraite par macération
ou décoction. Le jus est filtré et on y ajoute un mordant soit de la
lessive de cendre ou de l'alun , parfois les deux. Citons la garance,
l'iris, le genêt des teinturiers, le curcuma, la gaude, le sang de
dragon.
|
 |
|
Pigments d'origine animale: |
|
|
 |
C'est une partie de
l'animal, ses os ou la sécrétion d'une glande qui nous permettent
d'obtenir des couleurs.
La cochenille ou le Kermès nous donneront du rouge variant du carmin au
violet plus ou plus moins clair,
Les os calcinés vont produire des noirs plus ou moins intenses,
Une glande du murex permettait d'obtenir un pourpre qui servait à
teinter les parchemins mais nous n'avons pu à ce jour en retrouver la
recette. |
Pigments d'origine minérale:
Les ocres et
les terres sont obtenus par lavage et décantation. Elles donnent une
palette de couleurs très variées.
Certains minéraux doivent être réduits en poudre
par broyage: la cinabre, le lapis-Lazuli, la malachite, l'azurite....
Quelques uns contiennent des matières toxiques et
leur manipulation est réservée à des personnes averties:
l'orpiment, le réalgar...
D'autres encore s'obtiennent par oxydation en
utilisant du vinaigre, du marc ou de l'urine (celle d'un ivrogne
contient plus de tanin !): La céruse ou le vert de gris. |
 |
-
Les
liants :
Le liant permet au pigment d'adhérer sur le parchemin. Il existe
là encore plusieurs méthodes. Les plus usitées sont dites "à la
détrempe médiévale" ou "à tempéra". La première est à base
de blanc d'œuf, gomme arabique et eau de miel, tandis que la deuxième utilise le jaune d'œuf. Ces
préparations permettent de lier le pigment
finement broyé à l'aide d'une molette sur une plaque de verre ou de
pierre dure (j'utilise une plaque de granit polie).
Mélangés à la détrempe les pigments se conservent dans des
coquillages et s'emploient alors comme une peinture à l'eau. Ils
peuvent^également être conservés liquide ou en poudre.
A l'aide d'un pinceau on dépose la couleur en couches successive
sur le parchemin. La variation des couleurs se fait par superposition
de couches jusqu'à obtenir l'intensité voulue. Normalement on ne
mélange pas les couleurs entre elles, les fondus s'obtiennent par
superposition de couches de couleurs différentes. Et si quelques
pigments peuvent être mélangés il convient de s'en abstenir
absolument lorsque ceux-ci contiennent du souffre ou du plomb.
|
|